“Seule la classe moyenne voit la favela et ses habitants comme une bande de gens tristes, sans espoir. Il n’y a pas de lieu plus gai et vivant qu’une favela ! Je pense que nos soucis de planification du futur barrent notre spontanéité. Dans une favela la plupart des gens vivent au jour le jour. Cela a son mauvais côté, mais il y a du bon aussi”, c’est ce qu’affirme Fernando Meirelles, réalisateur brésilien de la “Cité de Dieu”. Rencontre.
Glauber Rocha, le plus grand réalisateur du Cinema Novo (mouvement d’avant-garde du cinéma brésilien – dont Rocha était le leader – des années 1960, pendant la dictature), a dit en 1969 dans une interview à Federico Cárdenas et René Capriles : “J’ai fait le film “Terre en transe” (“Terra en Transe”) dans l’intention que ce soit une bombe lancée contre les préjugés d’une certaine gauche académique, conservatrice et qui a donc réagi de manière névrosée. Cela a été positif. Au Brésil, le film a été lancé avec une grande polémique. Il a été interdit par la censure sous l’accusation d’être hautement subversif, immoral, et a été attaqué du point de vue politique, moral et sexuel…”
Est-ce que “Cidade de Deus” est le “Terra en Transe” actuel ? Je n’ai pas fait CDD pour être une bombe. Je n’avais aucunement l’intention d’attaquer des préjugés, de créer de polémique. La passion de Glauber pour les discours et pour les polémiques est dans ses films. Il aimait être au centre des discussions. Mon intention a été l’inverse. J´ai seulement voulu révéler une réalité. J’ai cherché à m’absenter le plus possible du film, si cela est possible… Je n’ai pas créé de polémiques, ou du moins j’ai essayé, car elles me fatiguent et, en général, sont stériles. Les films situés entre le documentaire et la fiction ont plus de rapport avec CDD.
En étant blanc, appartenant à la classe moyenne, fréquentiez-vous la favela ? Comment avez-vous réussi à tirer tant de poésie d’une réalité si écrasante ? Je n’avais eu aucun contact avec les favelas avant de commencer à préparer CDD. Je viens de São Paulo, j’ai déménagé à Rio pour réunir le cast du film et j’ai passé six mois en vivant tous les jours avec 200 jeunes des communautés démunies. Ce contact m’a mis dans le bain de cet univers. Et là il y a de la poésie et de l’espoir…
Nous vivons dans une société en guerre. Le sexe s’est banalisé. Le romantisme, c’est fini. L’espoir ne serait-il pas une idée de fou, d’aveugle, des pauvres ? Je suis un optimiste incorrigible. J’ai de l’espoir. Ce que j’aime faire le plus quand je ne travaille pas c’est de planter des arbres. J’ai une petite serre et je dois l’agrandir. J’ai même commencé à faire du reboisement dans une ferme que je possède. Non pour l’exploiter, mais juste pour refaire une partie de la forêt atlantique (forêt tropicale native du Brésil le long de la côte atlantique), avec un mélange de plusieurs espèces, beaucoup de bois nobles. J’ai déjà planté un jequitibá, un arbre qui vit mille ans ! Ceux qui plantent des arbres mettant cent cinquante ans à grandir ont certainement de l’espoir dans le futur… J’en fais partie.
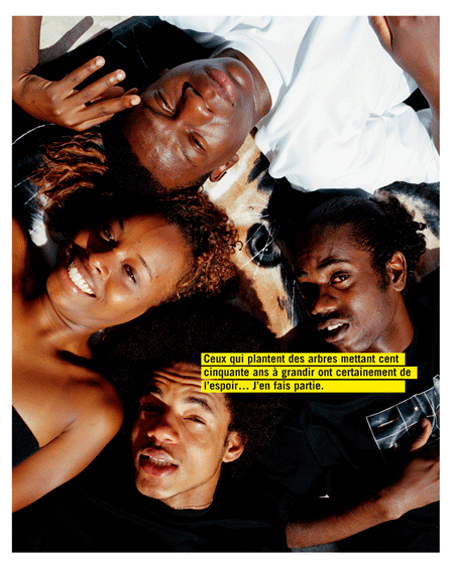
Comment avez-vous trouvé le financement pour le film ? Je me suis financé moi-même en me signant un chèque. C’est seulement après avoir tourné et monté le film que j’ai réussi à le négocier. J’ai assuré le projet tout seul depuis le départ. C’est la plus grande bêtise de ma vie, mais tout s’est bien terminé.
Il y a eu une prise de conscience après le film ? Malheureusement le film n’a rien changé de concret. Je ne m’attendais pas à cela non plus. Dans le quartier Cidade de Deus (la Cité de Dieu, quartier de Rio qui a inspiré l’œuvre de l’écrivain brésilien Paulo Lins, qui à son tour a inspiré le film), on a créé de nouveaux projets sociaux liés au sport, à l’emploi et à la formation professionnelle, mais rien qui puisse vraiment modifier le quotidien de cette communauté. Hélas.
Le cinéma brésilien n’apparaît que lorsqu’il montre la violence de notre société ? Ce n’est pas un problème du cinéma brésilien. On produit beaucoup de bons films avec d’autres visions du pays. Pensez à “Auto da Compadecida”, à “O Homem que Copiava” (L’Homme qui copiait), à “Amores possíveis” (Les Amours possibles), “A Partilha” (Le Partage) et tant d’autres. Beaucoup de comédies romantiques, de drames de la classe moyenne ou de films sur des personnages de notre histoire sont produits. Mais ces films ne semblent pas intéresser le marché international plutôt curieux de voir notre côté “exotique” ou problématique. C’est intéressant de remarquer que les films argentins sur la classe moyenne voyagent plus que les films brésiliens.
Lula, président, Gilberto Gil, ministre, on reste toujours “exotiques” ? Pendant que le monde semble pencher de plus en plus du côté républicain ou néo-libéral, le Brésil et même l’Amérique du Sud vont chercher des présidents plus à gauche. Cela éveille l’intérêt de l’Europe.
La scène politique internationale est à présent plus propice au cinéma vérité ou, au contraire, encourage l’illusion ? Le monde et le public sont de plus en plus pluriels. Je ne ferais pas de pari sur l’une de ces deux tendances, mais plutôt sur leur combinaison et plusieurs autres.
De nos jours l’art influence le cinéma ? Ou vice versa ? Il y aura toujours des échanges.
Que pensez-vous de Quentin Tarantino ? Il a créé une structure de scénario admirable pour “Pulp Fiction” et “Reservoir Dogs”, et il nous a surpris en montrant la violence comme “divertissement“. Mais il s’est arrêté là. Je n’ai pas réussi à voir “Kill Bill” jusqu’à la fin. Et je ne suis pas allé voir “Kill Bill 2”, en dépit des recommandations. La violence en tant que spectacle semble avoir perdu son sens dans ce monde où la violence réelle, montrée par les médias, est beaucoup plus spectaculaire.
Michael Moore ? Bien qu’il ne soit pas aussi précis qu’un universitaire ou impartial comme un juge, il apporte un point de vue et une manière de communiquer très sensibles. Il est devenu une référence et s’est affirmé par cette qualité. J’apprécie son travail depuis “TV Nation”.
Quels sont les réalisateurs que vous admirez ? “Iracema”, de Jorge Bodansky (réalisateur brésilien), est une référence pour moi. Il mélange le documentaire et le drame, révélant ce qu’était le Brésil au début des années 1970. La trilogie de Pasolini (“Arabian Nights”, “Canterbury Tales” et “Decameron”) m’enchante par sa structure, son style poétique, sa manière de révéler trois périodes et lieux de forme originale et profonde. “Lawrence d´Arabie” est un bon film, mais il n’arrive pas à révéler un monde comme fait le film de Pasolini. “Zabriskie Point” d’Antonioni, “Nashville” d’Altman, “Goodfellas” de Scorsese, “Apocalypse Now” de Coppola et plusieurs films de Kurosawa. Et, en revenant en arrière, “Man with the Movie Camera” de Dziga Vertov, de 1929, et l’avant-garde russe en général. Parmi les contemporains, j’aime beaucoup Paul Thomas Anderson (“Magnolia”, “Booggie Nights”, “Punch Drunk Love”), Pete Avalon, Michael Winterbottom, Alejandro Unarritú, Wan Kar Wai, etc., la liste est longue.
Quels sont vos prochains projets ? Je suis en train de finir le montage de “The Constant Gardener”, une production anglaise avec Ralph Fiennes et Rachel Weiz. Ensuite je tournerai “Intolerância” (Intolérance), une production brésilienne tournée dans sept pays, portant sur la mondialisation. Je dois aussi participer à quelques projets pour la télévision.
Comment sont vos journées ? Au cours de ces deux dernières années elles n’ont pas été très régulières. Rien qu’en 2004 j’ai changé dix-huit fois de continent. J’ai tourné en Europe, au Canada, en Afrique et au Brésil. Actuellement, je finis “The Constant Gardener” en même temps que l’O2, ma société de production, lance “Contra Todos” (Contre tous), un film de Roberto Moreira. Nous sommes aussi en train de produire une série pour TV Globo, “Cidade dos Homens” (Cité des hommes), et une autre pour HBO, “Carnaval”. En plus, il y a la production d’un film pour Philippe Barcinski, “Não Por Acaso” (Not by Chance), qui doit être tourné au mois d’avril, tandis que je termine le scénario d’“Intolerância”. Je suis plus occupé que je ne le voudrais…
Vous avez changé depuis ? J’espère que non. Je fais tout mon possible pour ne pas m’exposer. Je n’aime pas les photos, et j’accorde très peu d’interviews… Je fais tout pour ne pas devenir une “célébrité”.
Avec plus d’argent est-il plus difficile de ne pas tomber devant la tentation ? Plus facile d’oublier les idéaux ? J’ai fait une carrière à l’envers de la plupart des cinéastes. J’ai d’abord travaillé comme un esclave. J’ai construit une entreprise solide qui, à présent, me fait bien vivre. À quarante ans, quand je n’avais plus besoin de penser à comment gagner ma vie, j’ai commencé à faire du cinéma. Ce n’est pas un travail d’où je pense tirer une rémunération. Je prétends faire les projets qui m’intéressent. Et maintenant je vais dormir…
Fernando Meirelles a répondu à cet entretien pendant un vol Rio de Janeiro-Londres.
Interview : Cynthia Garcia Traduction : Luciano Loprete
Photographie : Matthieu Salvaing
Published : Printemps 2005 – DEDICATE 05


