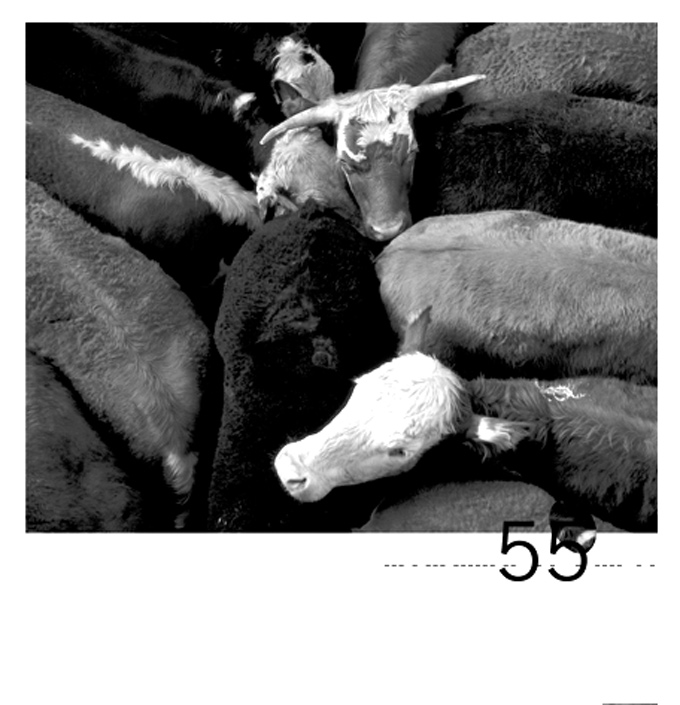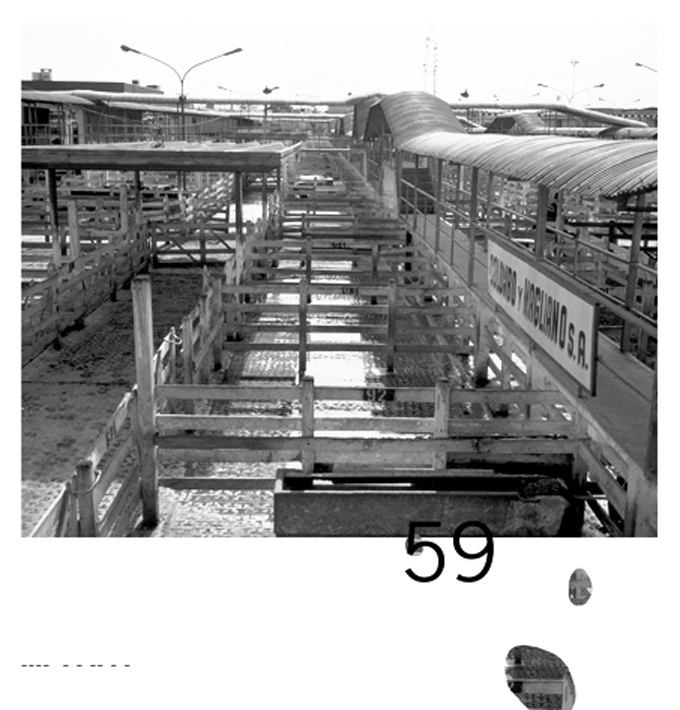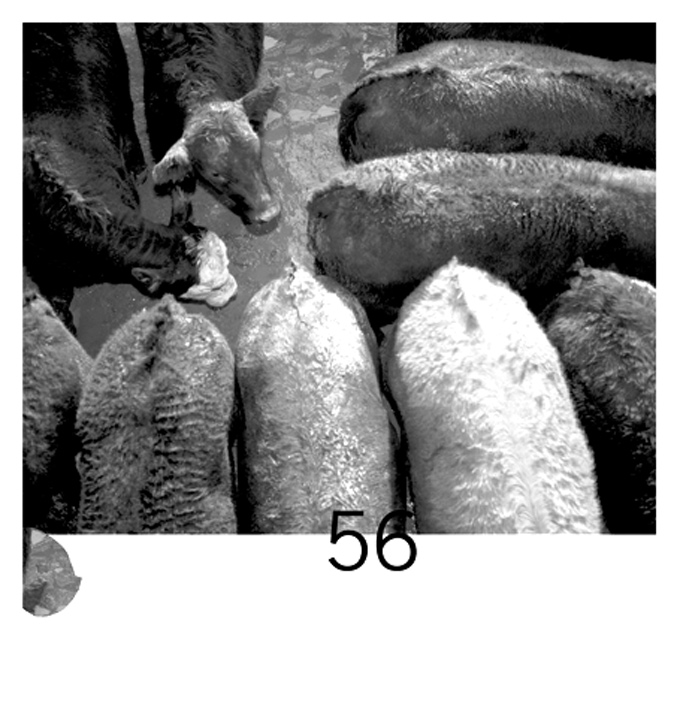À 18 ans, j’ai voulu quitter Paris pour Buenos Aires, en cargo. Me retrouver dans la ville de Borges, de Gardel et de Maradona. Vingt ans plus tard, j’atterris enfin dans la ville la plus occidentalisée de l’Amérique du Sud, une mégapole super branchée de douze millions d’habitants. Nous sommes en juillet. Le début de l’hiver. Je passe six jours solaires, entre rêve et réalité.

7 juillet
Aéroport Ministro Pistarini. Treize heures de vol en classe touriste, dos cassé, pas dormi. Il fait 20°C, mon manteau d’hiver est superflu. Tout le monde a la banane ! Je croise deux prêtres barbus en soutane noire, puis de grands types très costauds, des radios-taxis jaunes rutilants et une dizaine de vieilles Ford rouges Mustang Felton (1970 ?). Mon chauffeur me conduit au Centro, dans le vieux quartier du Recoleta, à une maison particulière, qui date de 1914, située dans un passage. On quitte les bruyantes avenues Leandro N. Alem, Del Libertador, ou 9 de Julio, large comme deux fois les Champs Élysées, pour un bloc de maisons construit par des Italiens, piqué aujourd’hui de petites tours malingres, situé à quelques mètres de la Bibliothèque nationale, sorte de champignon. L’intérieur de la maison, entre zen et colonial, possède un patio rempli de sculptures modernes. On prépare déjà un “assado” (morceaux de bœuf grillés) que l’on arrosera d’un malbec rouge sang de Mendoza après quelques “empenadas” de maïs. Blanca, cousine du Che, me reçoit. Grande, habillée de noir, les yeux éclatants, les cheveux couleur de jais. Tourbillonnante, elle m’explique où je suis et, en une heure, j’ai l’impression de tout savoir sur son quartier.

8 juillet
Six heures du matin. Depuis mon départ de Paris, je n’ai pas dormi, trop excité par le “matè”, une décoction amère d’herbes de la pampa, que l’on boit le soir, jamais seul, en l’aspirant avec une paille en argent (“bombilla”) dans une petite calebasse sertie. Ce rituel convivial remonterait aux premiers colons jésuites du XVIIe siècle. On peut rester éveillé pendant 48 heures dans “Baires”, ça ne ferme jamais : supermarchés, bars, restaurants, discothèques, abondent en centre ville, en service 24 heures/24. En revanche, impossible de trouver un café express sauf au café Tortoni (av. de Mayo 829, fondé par le Français Célestin Curutchet en 1858), avec des “churos” en plus ! Sur l’avenue et dans le parc Jorge Newberry, des étudiants promènent chacun des dizaines de chiens en laisse appartenant aux bourgeois du coin. Autre job inédit : des ados d’origine guarani (indiens du Nord) brandissent à chaque feu rouge, face aux voitures, des panneaux publicitaires (live show, boisson énergétique, etc.). Ici, on a parfois deux jobs. Sur les murs, des affiches anti- et pro-Kirchner, le président argentin qui veut promouvoir sa femme comme successeur. Partout, des cadres pressés et souriants. Rendez-vous au café La Biela (av. Quintana 596, sorte de café de Flore en moins snob, en face du Buenos Aires Design Museum) avec le critique Ernesto Schoo, chroniqueur à “La Nacion”, l’un des derniers témoins de Borges, grand spécialiste du théâtre argentin (des auteurs de 30-40 ans comme Patricia Zangaro, Alejandro Tantanian). Tout en dégustant sa collation (sorte de tapas locaux : tripes, saucisses, gigaolives), il se plaint de l’omnipotence culturelle américaine, des droits d’auteurs européens trop chers, mais reconnaît que les liens avec la France résistent (littérature, mode vestimentaire, luxe…). Pour le petit-déjeuner et le déjeuner, il conseille Clasica y Moderna (v. Callao 892), mélange de café-restaurant et de librairie, avec des minishows poétiques le soir. Ce soir, il ira chez Hermann (sud Palermo, au coin de l’avenue Santa Fe et de la rue Armenia, en face de son parc favori, le Jardin botanique) pour une bonne cuisine “portena” (pâtes italiennes et tourtes sucrées fabuleuses).
9 juillet
La nuit, cris d’oiseaux tropicaux. Chiens qui aboient. Pas de vrombissements. Réveil à 7 heures, je vais courir autour du Parque Las Heras. Humidité. Chaleur anormale pour un début d’hiver. J’oubliais : plus tôt, je me suis gavé de confiture de lait dont on farcit ici des minicroissants. Beaucoup de jeunes arborent des maillots de foot aux couleurs, soit de la France, soit de l’Italie. Je m’amuse à parier avec eux : demain c’est la finale ! Visite du Tiendamalba (av. Figueora Alcorta 3415), fondation privée pour l’art contemporain sud-américain, édifiée en 2002 par M. Costantini, le François Pinault local, qui en a confié l’architecture à deux jeunes gens de 25 ans ! L’ensemble, une dizaine de grandes salles, très Norman Foster, abrite des œuvres argentines du XXe siècle. Découverte du fameux Xul Solar (1887-1963), entre surréalisme et Klee, des érotiques kitchissimes d’Antonio Berni (1905-1981) et des sculptures-tableaux engagées de Pablo Suarez (né en 1937). Enfin, un artiste étrange, Florencio Molina Campos (1891-1959), assez inclassable, au style pseudo naïf, possédant un univers unique, qui refusa de bosser pour Walt Disney fasciné par ses univers Gaucho et Pampa, acide, comique, recréant des ciels vertigineux. Beaucoup de jeunes photographes comme Grosman, Lleo Casanova ou Pastorino, qui posent sur le “Big Buenos Aires” un regard décalé. Le soir, on se prépare pour aller regarder danser le vrai tango à San Telmo, quartier situé entre La Boca (piège à touristes) et le Microcentro (là, on trouve encore des putes, des mafieux, des bouges). Il s’agit d’un club privé, La Independencia (av. Independancia 572) dirigé par Omar Viola. La salle de bal est grande, entourée de belles tables où s’installent des familles entières, endimanchées, buvant du champagne (du Moët et Chandon local). Un orchestre ou une sono, c’est selon les soirs. Tango classique : Gardel. La main droite de l’homme serre le côté gauche de la femme, il pose délicatement sa joue sur elle. Il doit la guider. La salle embaume la nostalgie, la brillantine, la lutte aux couteaux, l’amour impossible – toutes les tailles, les âges et les conditions s’affrontent sur cette piste éblouie. Aucun touriste en vue.


10 juillet
Le matin, je vais visiter le stade de la Boca, là où Maradona a débuté… J’y suis allé à pied, quittant El Caminito, les échoppes multicolores à touristes. Je me perds et débouche sur les docks, face au Rio della Plata, la plus large embouchure du monde. En chemin, une prostituée édentée m’a demandé l’heure. À cinq minutes des cars de touristes, voici des centaines de maisons en ruine remplies de gens malingres, de gosses éperdus. Sur un mur blanc, la liste d’une vingtaine de disparus, enlevés pendant la dictature de 1976-1983. On dirait les noms d’une équipe de foot contemporaine : Levy, Battista, Di Patria, Sanchez, Epstein…
15 heures. Tout le monde est devant son poste de télévision. Une heure plus tard, personne n’a compris. Je me promets une soirée forte pour oublier tout ça : accompagné de Bianchita, Juan, Miguel et Isabella, neveux et nièces de Blanca, âgés de 20 ans, nous parcourons la ville dans des taxis (course à 2 euros) ultraspeedés. Direction : Palermo Viejo. Ici, environ deux cents boutiques de fringues (Maria Cher, Laura Driz…), de design et autant de restaurants, bars et autres clubs. Ouverture, fermeture, ça ne cesse de changer. Le swinging Buenos Aires se trouve Plaza Cortazar (s’il savait ! mais on lui doit “Blow up” d’Antonioni), inaugurée en 2004, un losange de lieux branchés ouverts en permanence. Très chic, le restaurant BoBo (Guatemala 4882) surmonté de son hôtel ultraminimal design (mais jacuzzi dans chaque chambre pour 100 dollars la nuit), avec une nouvelle cuisine argentine qui tente de dépasser le bon vieux “bife de chorizo” en offrant des mélanges sucrés-salés inédits et une cave remarquable à des prix modestes (25 euros, tout compris). Puis une dizaine de verres de Vasco Viejo (le vin local populaire), de Quilmes (bière servie en grande bouteille “tres-cuartos”), de pisco (alcool chilien étrange), et de shooters divers, pris au Lelé de Troya (av. Costa Rica 4901) qui offre une salle “lupanar chic”, tendue de rouge, avec chaise basse, lampes années 1920 et bougies baroques. Ça se câline dans tous les coins. Grande et souriante, Veronika Silva est là avec quelques amis. Longtemps actrice (cette brune incendiaire a joué ici du Shakespeare comme personne), elle prépare un spectacle de chant et de danse inspiré de la scène Tango Nuovo, leur dernier show s’appelait “Mi PiaNo RoJo” composé par Brifo. Son CD sort dans un mois (“Gorda”). Elle vit à Palermo Viejo et ne quitterait le coin pour rien au monde : “Ici, tout le monde se mélange, y’en a pour tous les goûts, tous les prix, c’est un peu la folie, mais ce qui domine, c’est la joie : après ce qu’on a vécu en 2002…” Question : “On va danser, mais où ?” Trop tôt : ici, la vie commence à 22 heures ! On dîne vers minuit. On danse vers 2-3 heures. Je supplie pour que ce ne soit pas du tango (trop corseté pour moi qui ne tient pas debout après une dernière “porron”, petite bière). À éviter : le Fernet-Branca ou le Gancia Batido, ces liqueurs ici très prisées (anticasquette) ressemblent à des médicaments contre la toux ! On décide, pour tester des cocktails inventifs (la jeunesse de Buenos Aires peut donc boire sans fin ?), un crochet par Mundo Bizaro (av. Guatemala 4802), très loungy-cosy, sièges en cuir noir, avec une énorme sculpture suspendue au-dessus du bar, des projecteurs d’images incohérentes. Un DJ passe un electrobeat mêlé de vagues tango.

11 juillet
Deux heures du matin. Ah, ça y est, la petite troupe se décide pour quérir un dance floor : le jeudi, c’est le Niceto Club (Club 69, Niceto Vega 5510) où mixe la sublime Romina Cohn. Il paraît qu’elle connaît intimement notre Laurent Garnier… Question à Veronika : “Quel est le groupe argentin le plus tendance ?” Réponse : “Babasonicos !” Romina comprend le message et passe un remix à sa sauce, base rock appuyé et nuages électro finement mêlés de percu latino. “Depuis plus de dix ans, ils ont su se renouveler sans cesse. Tu ne connaissais pas ? C’est dingue, c’est la meilleure vente chez Sony Music Argentina !” m’assène Blanchita, 20 ans, chanteuse, qui soudain explose de joie : “Voilà Pablooooo !” Surprise de taille : Pablo du groupe El Cholo arrive de Barcelone où il vit. Il est l’inventeur d’un nouveau son et sort un “virtual CD” (on line only !) très attendu (“Madre Fucking Patrias”). La boule à zéro, pur latino, il me parle de l’accueil dément qu’il reçoit en Europe : “Mon style a beaucoup de succès là-bas, mais je ne fais pas d’‘électrotango’. Je tente de fabriquer un son électro avec mon expérience acoustique personnelle qui se nourrit de tango, de folk argentin, de ‘cumbia villera’ (son né dans le grand Buenos Aires, en banlieue), de rock, funk, jazz… et, depuis Barcelone, le flamenco, les musiques du Maghreb… Un grand mix absolu !” Pablo est inquiet : vers 3 heures, sur la scène très Club 54, doit démarrer un “Horror Picture Show” qui déchaînera la foule (400 personnes). On se réfugie dans le chill out, magnifique, très “spirit”. Les conversations reprennent (à “Baires, ça talk talk talk sans fin !”) et on aborde les “bons plans” d’El Cholo : “En ce moment, c’est l’hiver. Il peut faire super humide, il faut quand même goûter les glaces : les meilleurs du monde se trouvent à El Piave (Avellaneda) ! Pour le vin, c’est El Club del Vino (Palermo). Ses deux spots pour le tango (dont il est fou, avec le jazz) sont : La Viruta (Palermo) et El Torcuato Tasso (San Telmo). Vers 5 heures, les gens rentrent se coucher. Visite vers 16 heures du studio de l’artiste vidéaste expérimental Leandro Katz, né en 1938, qui revient de plusieurs années passées à New York où il s’est fait un nom dans l’underground (sur l’image du Che, des ruines précolombiennes, des Amérindiens…). Sexagénaire fringuant aux yeux malicieux et aux cheveux d’argent, très classe, il a retrouvé la ville de son enfance car “ici, dit-il, nous expérimentons depuis la crise une ‘nouvelle renaissance’, une sorte de ‘movida’, tout bouge à vive allure et dans le bon sens.” Il me montre des photos de manifestations politiques et artistiques locales : “Tous les jours, les gens descendent dans la rue : l’expression de rue domine, Kirschner ne peut pas s’opposer à cet échange quotidien qui implique tous les ‘portenos’.” Il vient de boucler sa prochaine expo, “A los pies de la letra” (Au pied de la lettre) et participera en octobre à “Expotranstiendas” (une sorte de Fiac locale très courue par les collectionneurs nord-américains). Katz ne chôme pas : il termine aussi deux documentaires dans quelques semaines… En fin de journée, il m’indique la galerie de Daniel Maman (av. del Libertador 2475), très chic, très bondée, parce que présentant le fin du fin en matière d’artistes argentins les plus novateurs : Romulo Maccio, Alicia Penalba ou encore Karina El Azem, noms qui circulent à peine à Paris. Les toiles immenses de Mario Gurfein possèdent l’aura des contes les plus étranges d’un Cortazar, Bios Casares ou Sabato : porte, arbre, fenêtres et vastes étendues vertes ou rouges. Le soir, dîner au Thymus (Lerma 525), situé au nord de l’Abasto et du Recoleta : excellente cuisine du chef Fernando Mayoral formé par un Français (Michel Bras ?), inspiré par la Provence, la fraîcheur des herbes avec une siamese touch bien à lui.
12 juillet
Avant le départ, journée de rattrapage : Teatro Colòn (en travaux), église Notre Dame de la Guadalupe, Casa Rosada (palais gouvernemental, en travaux !), maison natale de Borges (on ne visite pas), Palais des eaux (Edificio de Aguas Argentinas) au style rococo… Déjeuner rapide sur les quais tous neufs du quartier Puerto Madero : tous les docks recyclés par les start-up informatiques, finances et autres, agrémentés de galeries, de show-rooms et de bars tendance “Costes-Garcia”. Espérons que les promoteurs, adeptes du patrimoine industriel, ne détruiront pas la salle multisports “Lunapark”, construite en 1936. Tout autour, des centaines de bouquinistes. Des jongleurs. Ici un vendeur de maïs grillé. Là, un cireur de chaussures. Une file de parieurs (courses de chiens). Un vent frais se lève, venu de l’embouchure du Rio della Plata, depuis les darses et les tourelles de déchargement. “Buenos Aires sera toujours une ville de contrebandiers”, me dit Blanca. L’hiver, qui tardait à venir depuis une semaine, vient d’arriver. Il est temps de rentrer.
Texte : Philippe Di Folco
Photographie : Philippe moisan
EXTRAIT DEDICATE 10 – Automne 2006