Au début des années 60, Jah créa le ska, musique “up-tempo”, et la donna en offrande à la jeunesse jamaïcaine. C’était un son totalement nouveau, basé sur le contre-rythme, aussi appelé le skank. Une véritable révolution sonore. Nul homme n’avait exploité auparavant ce filon musical.
La fougue de cette nouvelle génération laissa place – l’âge et la ganja aidant – à une langueur bienheureuse. Le rythme s’en trouva considérablement ralenti. Il frôla même l’arrêt cardiaque total au début des années 70. C’est alors que surgit du fin fond d’un des ghettos les plus pauvres de Kingston une bande de chevaliers intrépides qui détenaient en leurs mains le feu sacré, le Graal. Ils se nommaient les Wailers. Bunny Wailer, Bob Marley et Peter Tosh, les trois mousquetaires de Trench Town, qui, avec l’aide de leur producteur de génie Chris Blackwell (leur d’Artagnan), allaient faire de ce chant rebelle une musique à la portée universelle.
Un hymne poétique et politique qui s’engageait à reprendre le flambeau de la révolution pacifique, tout en affirmant la certitude que Jah, le Créateur, rendrait justice à tous les opprimés de la planète. Ce n’était qu’une question de temps, il suffisait de se ranger du bon côté, du côté des bons. Et chacun de découvrir soudain cette petite île des Caraïbes. Mais qui sont ces rastaquouères ? Quid de Jah ? Get up stand up, stand up for your rights ? C’est alors qu’une prise de conscience mondiale est née. Les sixties n’étaient pas mortes ; un autre monde devait toujours être possible. Là-bas aussi, ils souffraient d’injustices inacceptables. Qu’est-ce que le tiers-monde ? Tout. Qu’a-t-il été jusqu’à présent ? Rien.
C’était une musique militante, une musique pour maintenir les esprits éveillés. Pour se faire, la “Marie-Jeanne” était un allié indispensable dans la compréhension, la lutte et l’éveil spirituel. Fumer ouvre les yeux. En fumant, c’est un alter ego qui émerge en nous, un autre soi-même qui refuse de marcher pour le système, qui tourne tout en dérision, qui prône la contemplation et l’amour de notre mère Terre (et qui aime la grasse matinée). Peu à peu, la philosophie rasta a fait des adeptes, les conversions enfumées et en masse se sont multipliées.
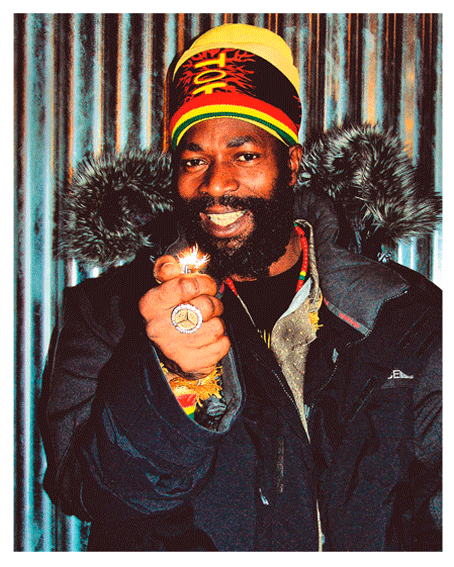
L’armée des ganja warriors s’est constituée ; leur chef s’appelait Robert Nesta Marley. La stratégie de Bob était simple : faire passer un message totalement contestataire sans effrayer le plus grand nombre. Ainsi, le reggae a toujours camouflé sa radicalité derrière de faux airs inoffensifs. On le croit utopiste, juste soucieux de dogmes plus ou moins farfelus. C’est ce qui fait sa force, son coté furtif. On se roule des pelles sur des paroles ultrapolitisées, et c’est dans ces moments de bonheur que notre cœur bat à gauche et qu’on se dit que c’est vrai quoi tout ça c’est vraiment trop injuste. L’idée de Marley, c’est de programmer tous ces gens en douceur, de les réveiller à petit feu jusqu’à ce qu’ils se lèvent un beau jour pour la défense de leurs droits et de ceux des “intouchables” de Babylone.
La force du reggae est d’être une musique bio-rythmique, qui, contrairement au gabba, se calque sur les battements du cœur quand il est au repos. Si vous souffrez de palpitations ou de tachycardie, allongez-vous, écoutez une chanson de Peter Tosh, respirez profondément et, en principe, au bout de quarante-cinq secondes, votre cerveau secrétera assez de sérotonine pour vous réaligner les chakras.
En somme, la victoire en chantant se profilait à l’horizon quand un triste jour de mai 1981, le général en chef Marley abandonna ses troupes à la soupe populaire de MTV. Qui était encore prêt à se lever ? Qui brandirait le poing ? Que restait-il de nos protest singers ? Lennon disparu, le punk caricaturé, les artistes se sont fait broyer un à un par la Machine de peur de s’engager politiquement au risque de réduire leurs parts de marché. De peur de perdre leurs contrats, si labellisés.
Dès lors, la bataille semblait perdue. Mais, même si le reggae avait été délaissé par les ondes, des poches de résistance se sont organisées. Chaque petite ville de campagne avait sa petite tribu d’ados accrocs au dub, antidote idéal aux excès des free parties. Aux six coins de l’Hexagone, le feu des joints a continué de brûler. Reggae’s not dead. Il a même un fils surdoué et turbulent, le dancehall, le rap jamaïcain, qui repart à l’assaut et explose les ventes dans le monde entier.
Le message de révolte des artistes de l’île n’a finalement jamais été autant d’actualité comme le montre si bien le documentaire “Made in Jamaica” de Jérôme Laperrousaz. Cependant, cette fois-ci, il prend plus la forme d’un cri d’alarme, voire d’avertissement, que d’un chant d’espoir. Les armes ont remplacé la “weed”. Le crack a balayé les volutes chloroformées de la nostalgie. La situation politique et sociale de l’île est au bord de l’implosion. Ce n’est pas un hasard si, dans ce contexte explosif, Damian Marley, fils de, a décroché le hit de l’année dernière avec le surpuissant “Welcome to jamrock” et ses paroles incendiaires. Tout un symbole.
Texte : Julien Allard et Mathew Bond aka The Peals
Photographie : Eddy Monsoon
EXTRAIT DEDICATE 13 – Eté 2007


